Éducation canine : le principal problème des programmes d’éducation contemporains est qu’ils reposent sur des postulats dont l’expérience démontre qu’ils sont faux !
Éducation canine, tant pis…
Sommaire

Cela dit en prenant le risque de rendre furieux les ayatollahs de l’éducation positive, par exemple…
Aujourd’hui, le monde de l’éducation en général, et celui de l’éducation canine en particulier, ont en commun d’être complètement imprégnés des théories comportementalistes.
Théories, apparues au siècle dernier avec les behavioristes anglo-saxons. Et le problème est que ces théories reposent sur un postulat dont l’expérience montre qu’il est faux.
Le postulat des comportementalistes
On peut résumer ce postulat des comportementalistes de la manière suivante :
- les êtres vivants ont tendance à reproduire les comportements qui leur ont apporté un bienfait,
- tout comme à éviter de reproduire ceux qui leur sont apportés un inconvénient.
Comportements conditionnés
Avec un corollaire à ce présupposé : tous les comportements peuvent être ainsi plus ou moins conditionnés, et il n’y a pas de comportements innés.
Le plus extrémiste des comportementalistes, un nommé Skinner affirmait par exemple que l’on pouvait apprendre n’importe quoi à n’importe quel être vivant.
Les seules limites étant les capacités cognitives et physiques des individus concernés d’une part, et l’habileté de l’éducateur d’autre part.
Éducation canine, dérive extrême : le mythe de l’éducation positive
Puisque l’on peut influencer les comportements, il devient inutile d’envisager de combattre d’éventuels comportements non souhaités !
En effet, dans ce système, ces derniers n’existent tout simplement plus ! Et c’est la grande découverte de « l’éducation positive » !
Ceux qui ont dit non !
Nous le savons : les critiques portées à la théorie comportementaliste ont été nombreuses ; citons parmi les éthologiques Konrad Lorenz, Karl von Frisch et Niko Tinbergen, les sociobiologistes avec Richard Dawkins et tant d’autres aussi…
Petit détour par les sciences sociales
Mais paradoxalement, c’est surtout du côté des sciences sociales, appliquées aux directions des ressources humaines en entreprise.
Pauvre résultat de « l’effet récompense »
Si les théories des comportementalistes étaient exactes, il deviendrait extrêmement facile pour les directions des ressources humaines d’optimiser les systèmes de motivation des salariés.
Or, l’expérience démontre que ce n’est pas le cas. Qu’il s’agisse d’un salaire, d’une prime, d’un intéressement, ou de n’importe quel autre système de motivation par la promesse d’une récompense, rien ne fonctionne durablement !
Et cela parce que « l’effet récompense » est celui qui s’émousse le plus vite.
Même sort pour l’effet punition
On démontrerait d’ailleurs que « l’effet punition » ne fonctionne pas mieux.
Cela n’a rien d’étonnant ; en effet, en dehors d’un point de vue strictement idéologique, il n’y a pas de différence entre les mécanismes d’influence de ces deux procédés ? Il est donc naturel que le second ne soit guère plus efficace que le premier.
Le mouvement des entreprises libérées
Le mouvement de ce que l’on appelle : « les entreprises libérées » part d’un point de vue complètement opposé. « Il est absolument impossible à un être humain d’en motiver un autre » affirme par exemple Bob Davids, propriétaire de « Sea Smoke Cellars », une de ces entreprises qui entendent se passer de hiérarchie et d’administration.
Pour ces nouveaux entrepreneurs, la seule manière efficace pour un dirigeant est de définir un projet. Puis de laisser chacun libre ensuite d’agir à sa guise.
Le vrai bonheur
En effet, selon eux, l’individu n’est pas heureux parce qu’il chasse une récompense ! Mais parce qu’il se trouve placé dans un environnement qui lui permet de s’automotiver ! De progresser, d’améliorer ses performances.
Le mieux que puisse envisager le dirigeant est de mettre à la disposition de ces individus les « nutriments » nécessaires à leur progression et à l’épanouissement de leurs capacités, puis de « laisser-faire ».
Éducation canine : pratiques statiques
Pendant ce temps, les pratiques en éducation canine restent étonnamment statiques.
Pourquoi ? Parce que dans les faits, elles restent totalement imprégnées des principes comportementalistes ! Et notamment de la théorie des récompenses (des renforcements). L’éducation positive s’affichant le dernier avatar de cette théorie.
Éducation canine : ce qui ne marche pas pour les humains n’a pas de raisons de marcher pour les chiens
Or, l’effet récompense, ou même l’effet récompense – punition, inefficace, nous venons de le voir, pour les individus de l’espèce humaine, n’a aucune raison de se montrer plus pertinent pour les autres individus des autres espèces !
Et c’est en effet le cas : les êtres vivants n’agissent pas pour être récompensés, ou éviter d’être punis. (Même si dans certains cas, une observation partielle ou incomplète peut donner cette impression.),
Le vrai bonheur du chien de chasse
Les chiens de chasse n’ont besoin d’aucune promesse de récompense pour aller jusqu’au bout de leurs forces, quand ils sont à la chasse, parce que l’action de chasser est en soi leur récompense et suffit à leur bonheur.
Le secret des chiens berger
Avez-vous déjà vu un berger « récompenser » ses chiens de berger, qui pourtant font preuve d’une extrême énergie à exercer leur travail ? Non, bien sûr. Pour un chien berger, la garde et la conduite des troupeaux sont en soi sa récompense. Aucune autre ne lui serait de quelque nécessité que ce soit.
Éducation canine : la vérité des êtres vivants
La conclusion de tout cela est que, comme les êtres humains, les êtres vivants n’agissent pas pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Mais fondamentalement, pour se trouver en harmonie avec leur environnement. En harmonie avec leur environnement, ils s’automotivent, ils progressent et améliorent leurs performances.
Tout ce que nous pouvons faire est de mettre à la disposition de l’animal les « nutriments » nécessaires à son développement et à l’épanouissement de ses capacités. C’est à l’animal lui-même de faire le reste, et nous n’avons ni la capacité, ni d’ailleurs le droit moral de le faire à sa place. Nous n’avons que la capacité et sans doute le droit moral de « laisser faire ».
Un sujet sur lequel nous reviendrons prochainement.
Extrait du « Comportement dans tous ses états », à paraître dans le courant du mois de juillet : réservez votre exemplaire en nous écrivant : hello@audreco.com
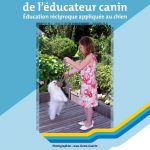
Pour en savoir plus :
nos formations
nos livres
- Apprendre les positions à votre chien : pourquoi ? Comment ?
- Manuel de l’éducateur canin
- Éthologie du loup, éthologie du chien
- Découvrez comment mieux comprendre votre chien : tout savoir sur ses cinq sens !
- et nos autres titres : Ici !

0 commentaire