Donnons-nous réellement à nos chiens une « juste » place ?
Vous préférez écouter :
Consensus aujourd’hui : le chien occupe, dans les familles, une place toujours plus importante, nouvelle, qu’il n’avait pas autrefois.
Rien n’est plus faux cependant. C’est vrai, hier, une majorité de chiens étaient « d’utilité » : chasse, garde, guerre…

Le chien d’utilité est incontestablement devenu minoritaire, laissant la place majoritaire au chien « de compagnie ». D’ailleurs, même lorsqu’il est réputé avoir encore une utilité, ce qui est de plus en plus rare, la fonction compagnie l’emporte dans les faits.
Combien de chiens de chasse ou de garde sont désormais plus habitués au confort des coussins familiaux qu’à la rudesse des chenils ou celle des niches du temps passé ? Pour autant moins doués pour leur fonction d’utilité ? Je laisse les propriétaires concernés en juger…

Ce qui est sûr, c’est que, contrairement à la légende urbaine, le chien de compagnie n’est pas du tout une nouveauté contemporaine, bien au contraire. En témoignent tant de tableaux de peinture classique ou même plus ancienne, de familles, royales, nobles, princières, ou même seulement bourgeoises, qui ne sont que rarement représentées, sans la présence d’un ou de plusieurs chiens de compagnie, apparemment très à l’aise, et tout à leur place dans les décors les plus luxueux…

Sautons à pieds joints par-dessus ces époques, et retournons à la préhistoire : Claude Lévi-Strauss, pour ne citer que cet illustre anthropologue, nous a abondamment décrit comment les tribus primitives s’entouraient d’animaux de compagnie, et donc surtout de chiens, pour lesquels étaient consentis des efforts sans commune mesure avec les efforts modernes, si l’on veut bien tenir compte des niveaux de vie des uns et des autres. C’en était tout point que, dans certaines tribus primitives, le premier né d’une jeune femme était abandonné au profit d’un chiot ou d’un louveteau…

Rien de moderne, donc, dans notre passion pour le chien de compagnie, et à mon avis, beaucoup de sujets d’interrogation. À commencer par cette question : le chien de compagnie est-il vu d’abord pour ce qu’il est réellement, un chien ? Avec cette seconde question connexe, est-ce que cette façon de faire est si bonne que cela pour lui ?

Première remarque : aveuglés par notre réflexe anthropomorphique, nous savons très mal résister au réflexe de projeter sur notre compagnon les sentiments qui seraient les nôtres si nous étions… lui ! Reconnaissons-le, même s’il a des poils et s’il est à quatre pattes, nous voyons le chien comme un autre nous-même, ce que malgré tout il n’est pas réellement.

Entre en jeu une autre difficulté : le chien lui-même, qui conditionné par des siècles de cohabitation avec nous, présente une incroyable capacité d’imitation et d’adaptation à nos attentes. C’est même sans doute cette capacité la principale cause génératrice de la cohabitation de nos deux espèces.
Un exemple parmi cent, mille autres pour illustrer mon propos, exemple souvent décrit : le bâillement du maître entraîne souvent celui de son compagnon. L’agitation d’un propriétaire engendre, presque mécaniquement, celle de son camarade à quatre pattes… Le chien nous imite, ou adopte des comportements fortement influencés par les nôtres.

Entre un conducteur qui voit le chien à travers les lunettes de son anthropomorphisme et un chien qui joue volontiers le jeu de cette attente, on découvre que la réalité de l’animal échappe bien souvent, trop souvent, à notre sagacité. Et pour vous le dire comme je le pense, je ne suis pas sûr que ce soit tant que cela un bien, ni pour le chien, ni pour nous-même…
Un autre nous-même, que cela peut-il nous apporter ? La non-découverte d’une autre réalité que la nôtre, n’est-ce pas là une dommageable amputation ? Et tout compte fait, pour chacune des deux parties ?
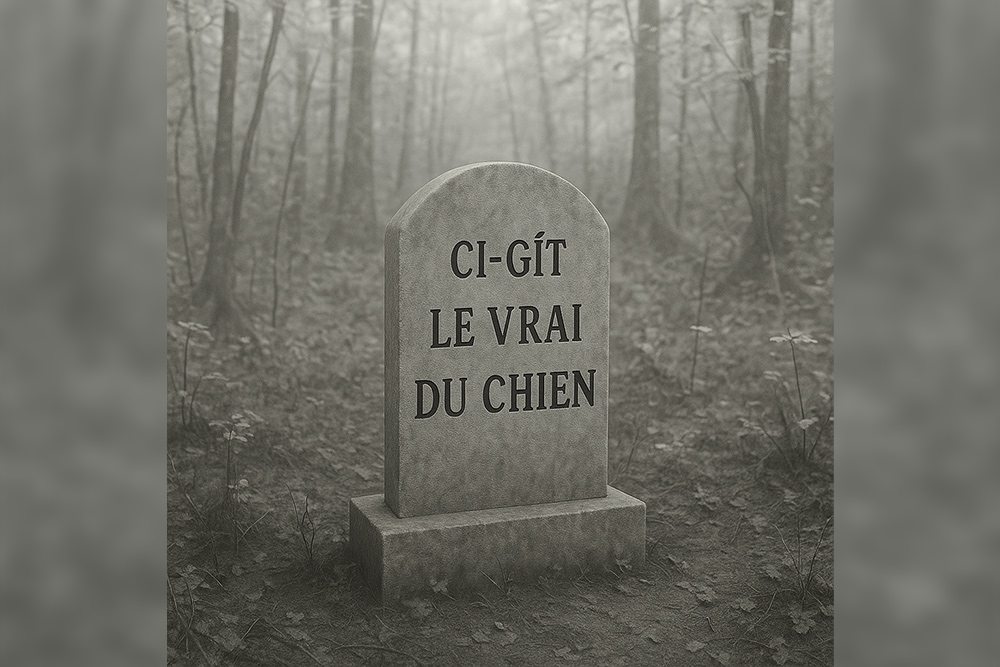
Vous voulez aller plus loin ?
Notre librairie : https://librairie.audreco.com/
Nos sites : https://audreco.com/, https://michelgeorgel.com/monde-animal/
0 commentaire